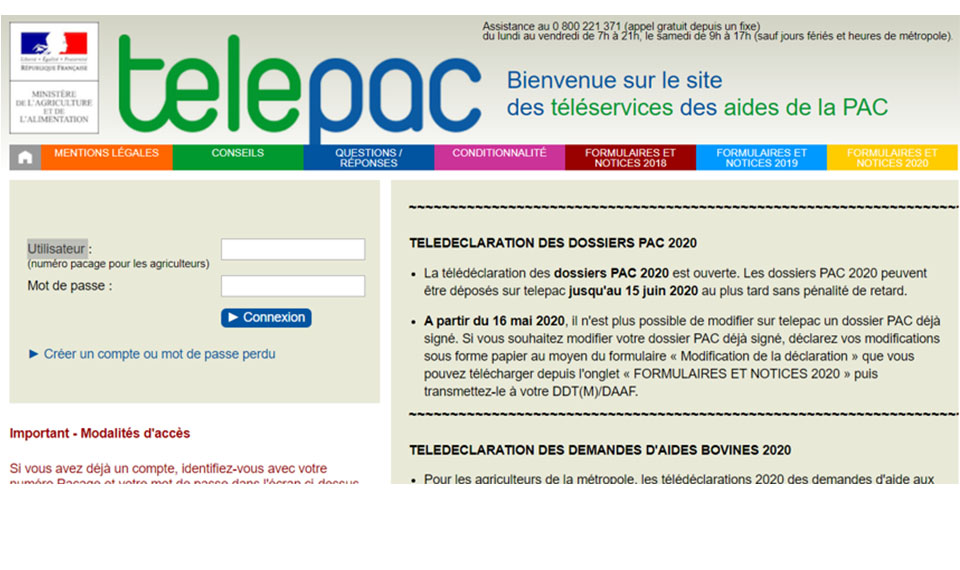
Les trois règlements qui composent le paquet de réforme de la PAC signés conjointement par le Conseil et le Parlement de l'Union européenne viennent d'être publiés au Journal officiel. Ces nouvelles dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2023.
Si l’architecture générale de la Politique Agricole Commune n’est pas modifiée en profondeur, les objectifs fixés par la Commission dans sa communication du 29 novembre 2017 sur « l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture » ont été pris en compte, à savoir : axer davantage la PAC sur les résultats et le marché ; stimuler la modernisation et la durabilité économique, sociale, environnementale et climatique des secteurs agricole et forestier ; contribuer à réduire la charge administrative qui pèse sur ses bénéficiaires ; rationnaliser sa gouvernance ; et laisser aux Etats membres une plus grande marge de manœuvre pour adapter les mesures aux conditions et aux besoins locaux.
Aussi, les changements les plus significatifs portent sur :
– les paiements directs et les interventions en faveur du développement rural plus ciblés et soumis à une planification stratégique ;
– une approche fondée sur des résultats selon laquelle les Etats membres devront rendre compte chaque année ;
– une nouvelle dimension écologique fondée sur les conditions environnementales auxquelles devront satisfaire les agriculteurs et des mesures facultatives supplémentaires au titre des deux piliers.
Une plus grande flexibilité et une planification stratégique
Un ensemble unique d’objectifs sont fixés au niveau de l’Union européenne pour l’ensemble de la PAC, présentant des résultats que cette politique cherche à atteindre pour les agriculteurs, les citoyens et le climat. A partir de ces objectifs, chaque Etat membre doit élaborer son propre plan stratégique dans lequel il décrit comment il entend atteindre ces objectifs en analysant ses besoins et ses outils, en définissant des actions et des objectifs, et en présentant les interventions spécifiques en faveur des agriculteurs. Il doit, en outre, définir, à partir d’un niveau minimal de l’activité agricole, « l’agriculteur actif » qui pourra bénéficier des aides communautaires.
Chaque plan stratégique doit préciser la manière dont l’Etat membre utilisera les financements de la PAC pour satisfaire à ses besoins.
Pour ne pas donner lieu à 27 politiques agricoles nationales différentes, chaque plan stratégique devra être soumis à l’approbation préalable de la Commission qui veillera à ce qu’il reste cohérent avec les objectifs définis à l’échelle de l’Union européenne et à ce qu’il ne fausse pas le marché unique, ni ne génère une charge excessive pour les bénéficiaires ou les administrations.
Les Etats membres soumettront à la Commission des rapports de performance présentant les progrès accomplis dans la réalisation de leurs objectifs fixés comme indicateurs de résultats. Cette dernière examinera ces rapports et proposera, le cas échéant, des recommandations visant à améliorer les résultats.
Un accent mis sur les résultats
Il est demandé aux Etats membres de planifier leurs interventions sur la base de résultats clairs et de rendre compte de leurs performances en regard aux objectifs de leurs plans stratégiques. Une vaste boîte à outils comprenant des types d’intervention généraux déterminant ce qu’ils peuvent faire pour atteindre ces objectifs ainsi qu’un ensemble d’indicateurs de résultats doivent leur permettre de garantir des conditions équitables dans le cadre de l’évaluation de l’efficacité des mesures appliquées.
Le soutien financier accordé aux agriculteurs devra dépendre de leurs pratiques bénéfiques pour le climat et l’environnement.
Un soutien financier plus ciblé
Un nouveau cadre juridique dans un règlement unique couvre les aides de l’Union européenne financées par le FEAGA et le Feader en lieu et place des deux règlements précédents.
Afin de répartir plus équitablement les paiements par agriculteur, le soutien au revenu pourra être réduit et plafonné dans le cadre d’une redistribution plus globale des aides des grandes exploitations aux plus petites afin de leur donner la priorité ainsi qu’aux jeunes agriculteurs.
A cette fin, les Etats membres devront veiller à ce que d’ici 2027, tous les droits au paiement présentent une valeur au moins supérieure ou égale à 85 % du montant moyen national au titre de la convergence interne. Au titre de la convergence externe, les Etats membres dont le niveau d’aide moyen par hectare est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union européenne veilleront à ce que la moitié de cet écart soit comblé d’ici 2027.
Les Etats membres seront autorisés à réduire jusqu’à 85 % les paiements directs au-delà de 60 000 € par an et par agriculteur et à les plafonner à 100 000 € par an, les salaires agricoles pouvant être déduits avant la réduction et/ou le plafonnement de ces paiements.
Par ailleurs, les Etats membres devront redistribuer au moins 10 % de leurs dotations en faveur des paiements directs des grandes aux petites et moyennes exploitations, à moins qu’ils ne préfèrent répondre au besoin de redistribution par d’autres moyens et qu’ils soient en mesure de démontrer que ce besoin est suffisamment pris en compte.
Les Etats membres seront également dans l’obligation de réserver au moins 3 % de leur enveloppe nationale aux jeunes agriculteurs, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la PAC précédente.
Des pratiques agricoles plus vertes
L’architecture du 1er pilier de la PAC est modifiée pour substituer au paiement vert les éco-régimes.
Des paiements spécifiques issus des programmes écologiques seront versés aux agriculteurs qui adopteront des pratiques tenant compte du changement climatique et respectueuses de la biodiversité, telles que l’agriculture biologique dont les aides à la conversion vont être augmentées de 30 % mais les aides au maintien supprimées, la rotation des cultures qui vient s’ajouter aux règles de la conditionnalité avec l’introduction d’une part de surface improductive, ou encore la préservation des sols riches en carbone visant à protéger les zones humides ou les tourbières.
Les Etats membres devront intégrer dans leurs plans stratégiques ces programmes écologiques en vue d’aider et/ou d’inciter les agriculteurs à respecter outre les exigences obligatoires, des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. Ils devront consacrer à cet effet 25 % de leurs paiements directs à ces programmes avec la possibilité toutefois de n’y consacrer que 20 % en 2023 et 2024.
Des obligations en matière de droits sociaux et de droits du travail
Le respect des conditions sociales et de travail des travailleurs agricoles devra être contrôlé par les Etats membres au plus tard à compter du 1er janvier 2025, et les organismes payeurs agricoles seront habilités à prendre des sanctions envers les employeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations.
Une organisation commune des marchés agricoles ajustée
Si les dispositifs existants, qu’il s’agisse des achats de produits par l’intervention, des droits de douane aux frontières extérieures notamment, restent inchangés, les aides à l’exportation ne sont pas reconduites en application de la décision ministérielle du 19 décembre 2015 sur la concurrence à l’exportation arrêtée lors de la 10ème conférence ministérielle de l’OMC.
En ce qui concerne le secteur vitivinicole, le régime des plantations est prolongé jusqu’en 2045, mais avec deux réexamens à mi-parcours à réaliser en 2018 et en 2040.
Les procédures relatives à l’enregistrement des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées, et des spécificités traditionnelles garanties sont rationnalisées et simplifiées.
Les programmes opérationnels par production conduits par les organisations de producteurs pourront être conduits par prélèvement sur l’enveloppe de paiements directs du 1er pilier.
En cas de crise sur les marchés agricoles, les mesures à prendre par les Etats membres sont précisées, la réserve budgétaire de crise étant fixée à 450 millions d’euros au début de chaque année de la période 2023-2027.
Règl. (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, 2 déc. 2021 : JOUE n° L 435, 6 déc. – Règl. (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil, 2 déc. 2021 : JOUE n° L 435, 6 déc.- Règl. (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil, 2 déc. 2021 : JOUE n° L 435, 6 déc.
Site EditionsLégislatives 13/12/2020